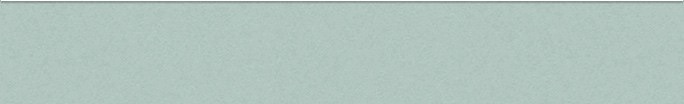SAINT GILLES DE CRETOT
Le domaine de la Picotière, ancien fief de Claville, est acquis par Albert Lefort à la fin du XIXème siècle qui transforme radicalement un ensemble dont les parties les plus anciennes remontent au XVIIème siècle.
Ainsi, à proximité d’une mare transformée en pièce d’eau maçonnée, il fait construire une glacière. Cette glacière date de la seconde moitié du XIXème siècle ; elle est bâtie en briques, avec un emploi ponctuel de silex encadrant l’entrée
La cuve conique est profonde de 3,50 mètres, pour un diamètre de 10 mètres, elle est couverte d’une voûte de briques, et conserve grille et échelle.
La glacière de la Picotière
Les glacières d’emmagasinement en Haute Normandie



Combien de temps pourrons-nous apercevoir ces édifices devenus inutiles, les glacières. Construites depuis le XVIIème siècle jusqu’ la fin du XIXème, elles disparaissent rapidement.
Sur les quelques centaines en service sur la Seine Maritime au début du XIXème, combien en reste-t-il à ce jour en bon état ? Quelques dizaines au mieux. Désormais inutiles, irrécupérables pour d’autres usages, discrètes puisque peu visibles, elles s’effondrent, se bouchent et la végétation les recouvre.
Les glacières d’emmagasinement en Haute Normandie
Utilisation des glacières
L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751) définit une glacière comme « un lieu creuser pour y serrer de la glace ou de la neige pendant l’hiver afin de s’en servir l’été. »
Dans notre région la glace entreposée est, en principe, impropre à la consommation puisque ramassée sur les mares et les pièces d’eau.
A quoi servait donc cette glace ? Tout d’abord et principalement à faire des boissons glacées et des sorbets en entourant le récipient contenant les boissons ou les fruits à rafraîchir de glace pilée et de sel. Au XVIIIème siécle, ces rafraîchissements étaient rares er coûteux, comme le montre l’anecdote suivante extraite des « Mémoires pour servir à l’histoire de Dieppe » de Michel Guibert : Le 14 août 1772, la Duchesse de Chartres, mère du futur roi Louis-Philippe, était reçu par la ville de Dieppe. Il n’y avait dans cette ville aucune réserve de glace et il fallut avoir recours à une voiture attelée de trois chevaux pour aller à Derchigny où la seigneur du lieu, M. Gabriel de Clieu possédait dans la glacière de son château cet exceptionnel et précieux produit.
Cette glace était aussi employée en médecine. L’Encyclopédie de Trousset (1875) après avoir attiré l’attention sur les dangers des boisons rafraîchissantes : « leur usage est interdit aux enfants, aux convalescents et aux estomacs débiles ; pendant le travail de digestions, l’ingestions des ces substances pourrait provoquer des indispositions » précise que la glace, dans le traitement de beaucoup de maladies, est un médicament de première nécessité.
Outre le bien-être qu’elle procure au malade consumé par la fièvre, que d’affections cérébrales, que de péritonites et autres inflammations du ventre enrayées par l’usage de la glace.
Jusqu’au début du XXème siècle les villageois allaient demander et chercher au château, seul possesseur d’une glacière, cette glace souhaitée pour soigner un malade.
Enfin, et ce point semble curieux à notre époque où chaque foyer possède un réfrigérateur, l’usage de la glacière pour garder plus longtemps les aliments semble exceptionnel. Il faut attendre le milieu du XIXème siècle pour lire dans le manuel Roret (Nouveau manuel complet du limonadier, glacier, cafetier et de l’Amateur de thés et de café) des conseils aux possesseurs d’une glacière vivant à la campagne en été sur la conservation des viandes, beurres et autres provisions. Le sas existant à l’entrée d’une glacière entre les deux portes semble le lieu le plus approprié pour cette réfrigération.
Construction d’une glacière en Normandie
La construction d’une glacière a toujours été une opération onéreuse car elle doit se situr dans une lieu avec des caractéristiques bien précises. A part les quelques glacières construites dans les villes (Rouen, Caen, Dieppe, Fécamp …) dont le produit était vendu en été fort cher aux habitants, la possession d’un tel local était le fait de riches particuliers qui les faisaient construire dans le parc de leur propriété en un lieu quelquefois très éloigné de l’habitation principale.
Implantation de la glacière
L’emplacement doit être choisi avec un grand soin : il doit être sec car la glace fond si l’humidité traverse les murs. Pour cette raison, la première année, la glacière conservera mal la glace entreposée, la maçonnerie n’étant pas encore entièrement sèche.
Le lieu doit être, soit au flan d’une colline, soit sur une butte, car il faut évacuer les eaux de fonte de la glace entreposée. Enfin, l’endroit doit être frais et peu ensoleillé, ce qui se résoudra facilement grâce à des plantations d’arbres.
Saint Gilles info n° 2 d’octobre 1994
L’église
L’église, construite sur une butte, domine le village.
Elle est du XVIIIème, avec quelques vestiges du XVIème siècle. Le chœur forme un demi-cercle, le soubassement en est de pierres et de silex taillés, puis la brique rose remplace la pierre. Cet appareillage se continue le long de la nef. La chapelle latérale sud-est est en pierre blanche, la façade en brique rose, la façade et le clocher couverts d’ardoises.
L’église abrite aussi une jolie statue de vierge du XVème, une statue de Sait Leu et Saint Sébastien, un joli bénitier et des fonds baptismaux de pierre.




Le cimetière qui l’entoure est clos par un mur bahut, au bel appareillage de silex taillé que l’on retrouve à l’entrée du bourg, dans un beau bâtiment rectangulaire couvert de chaume.
Saint Gilles n’était qu’une simple chapelle. En 1114, Henri Ier, roi d’Angleterre et duc de Normandie, la donna à l’abbaye de Saint Georges de Boscherville. Plus tard, seconde cure de Crétot, Saint Aubin et Saint Gilles ne formaient qu’une seule paroisse. Au XIIIème siècle, la chapelle de Saint Gilles, érigée en paroisse, passa entre les mains du roi de France. C’est pour cela que cette modeste église prit le titre de chapelle royale.
Selon une très vieille tradition, une habitation, le long du chemin appelé rue de Saint Gilles, abritait le premier sanctuaire du village. En 1876, cette construction servait de grange. Mais, personne au village n’en a gardé souvenir.
source : géographie du département de la Seine-Inférieure
de l’abbé J Bunel continué et publié par l’abbé A Tougard en 1876
Le manoir de Coquesoit

Le manoir de Coquesoie, orthographié aussi Coquesoye ou Coquesoit, est une ancienne et superbe demeure située sur le sommet d’un éperon dominant les forêts de Saint Arnoult et de Maulévrier.
Le colombier qui s’élevait autrefois a disparu, mais l’allure encore « militaire » de la demeure frappe encore aujourd’hui le visiteur de toute sa noblesse.
Deux types d’architecture apparaissent en façade : bâtisse du XVIème siècle, puis après les troubles de cette période, il a été rajouté une aile moins bardée de fer mais agrémentée de pan de bois. Avec la paix rétablie par le roi Henri IV, s’élabore un mode de construction plus orné, encore que resté défensif, mais moins rébarbatifs, et les ouvertures s’élargissent. Pierres en bossage, claveaux proéminents se détachent sur fond de briques, cailloux et silex sont abandonnés au profit de la brique et du bois.
Le site de cette belle propriété, et cela est prouvé par toutes les pierres taillées, silex et autres trouvés dans les environs immédiats, a connu une vie intense et une occupation humaine certaine bien avant l’époque gallo-romaine et celle des Calétes, peuple gaulois établi dans notre Pays de Caux.
Saint-Gilles Info n° 9 – 1994
Le château de la Viézaire
Le Château de la Viézaire date lui aussi du XVIIIème. Deux pavillons de briques à chaînage de pierres et toit à la Mansart encadre un avant-corps de pierre surmonté d’un fronton triangulaire. Dans l’angle sud-ouest du mur qui entoure le parc, s’élève une jolie chapelle désaffectée.



Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie






Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie








Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie







Château de la Viézaire, bâtiments de l’exploitation agricole
Manoir de la Picotière
Ferme et bâtiments de l’exploitation agricole, manège (à droite)
Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie
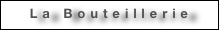
Les fermes anciennes









La statue de Saint Gilles date des années 1400. Elle figure sur la liste des objets classés monuments historiques.
La Bouteillerie, ferme du 17ème et 19ème siècle
logis, étables, grange, remise
pressoir à cidre, four à pain
Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie
Ferme du 18 et 19ème siècle
Le four à pain et la grange sont aujourd’hui disparus (photos du bas)
Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie




Fermes du Haut Hôtel du 18ème siècle
Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie


Ferme du 18ème siècle
Photographies Lemouton © de 1974 :
inventaire général
du patrimoine culturel,
Région Haute Normandie







Les mairies


La mairie-école d’antan, et la mairie d’aujourd’hui
-
 Les mairies
Les mairies -
 La glacière, le manoir de la Picotière
La glacière, le manoir de la Picotière -
 L’église
L’église -
 Le manoir de Coquesoit
Le manoir de Coquesoit -
 Le château de la Viézaire
Le château de la Viézaire -
 Les fermes anciennes
Les fermes anciennes